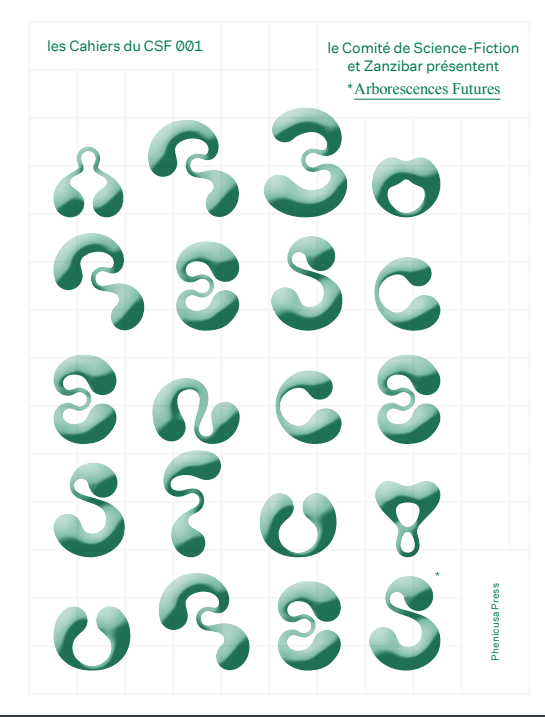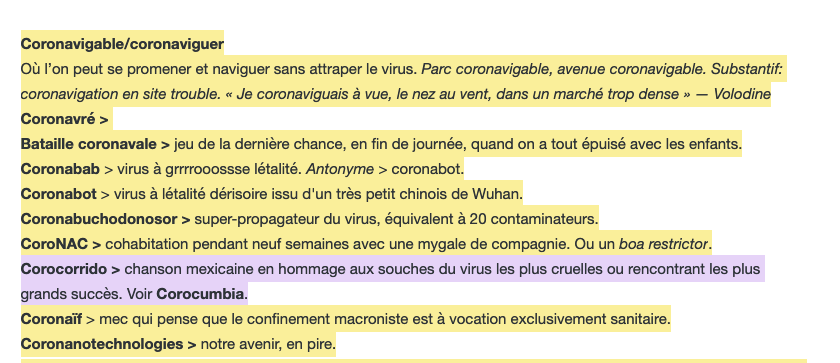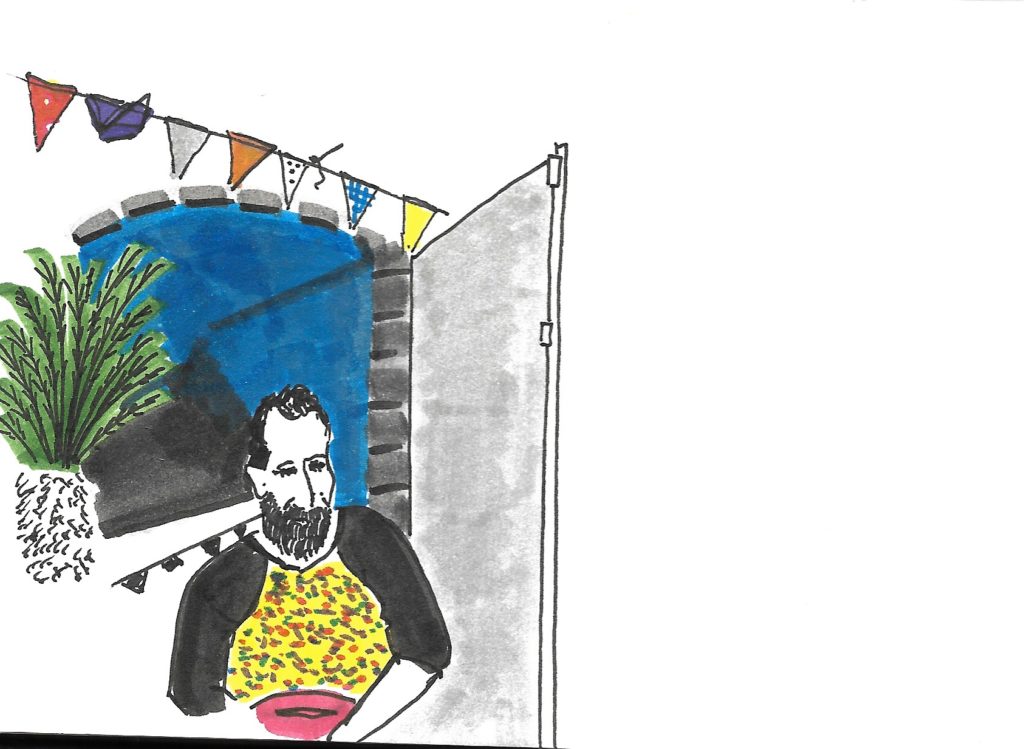Rêves & animaux – atelier zanzibar via jitsi du 26/03/20
Stuart,
Léo, luvan
1.
- chacun
raconte un rêve qu’il a fait récemment
- à
partir de ce rêve, on a une 30 min pour écrire une histoire
2.
- les
animaux dans la ville en temps de confinement
- carte
de tarot
- 30
min
Léo
1
Ce
dont je me souviens du rêve de Stuart : anniversaire de Marius,
on lui offre un éléphant, il faut le faire monter dans un escalier
en colimaçon, appartement soviétique, il fait sombre, mais
finalement on vit bien avec cet énorme animal dans l’appartement.
On
a recommencé à vieillir.
C’est
venu comme ça, un matin, Olga a regardé le calendrier, celui avec
les photos d’animaux, elle a tourné deux, trois pages, et s’est
arrêté face à deux marcassins qui se grimpaient dessus, elle a
dit : c’est demain.
Demain
quoi ? a grogné Olaf.
L’anniversaire
du petit.
Le
petit a levé un œil de son bouquin, il relisait la Flexion de la
phrase verbale à l’époque alfrédienne tout
en surveillant la cavale du couvercle de cocotte : quand
l’ébullition reprenait, il se mettait à glisser tout doucement,
millimètre par millimètre, jusqu’à se jeter, de toute la hauteur
de la cuisinière, sur les dalles en béton. Osgür et Ornelle ont
posé leur ouvrage presque en même temps, leurs gestes en miroir,
ils s’asseyaient toujours face à face et avaient fini par gagner ça,
cette précision, cette expertise dans la chorégraphie. Ils
avançaient au même rythme dans leurs broderies, seules les couleurs
changeaient. Oncle Oscar, Olie l’Oursonne et Otto d’en Haut étaient
allongés et dormaient, ou bien faisaient semblant de dormir, sur les
trois surfaces planes prévues à cet effet dans la cuisine. On
pouvait pas leur en vouloir, c’était leur tour, et leur tour
passerait bien assez tôt.
Olga
a répété, catégorique : c’est demain. Puis, un ton plus
bas : et peut-être même aujourd’hui, peut-être aujourd’hui
même. Puis, à l’usage de ceux qui n’avaient pas les yeux fermés,
ceux dont c’était le shift dans la cuisine, elle a ajouté : va
falloir lui trouver un cadeau. Bouche-toi les oreilles, petit !
Petit
O à hoché la tête comme ça, exaspéré peut-être, peut-être
juste chassant une mouche, et il a replongé le nez dans son tome
comme si de rien. Comme s’il en avait rien secouer que le temps se
soit remis à passer. Comme si vieillir, grandir, ça n’était plus
très important, finalement, ou alors bien moins que les subtilités
syntaxiques du vieil anglosaxon.
Mais
pour nous tous, c’était déjà trop tard.
Ornelle,
qui a l’ouïe la plus fine – c’était elle qui se réveillait, la
nuit, quand la veilleuse du chauffe-eau faiblissait, elle qui
relançait le brûleur à temps avant que ça ne s’éteigne, avant
qu’on ne gèle tous ensemble, que la chaleur humaine ne se dissipe –
a levé son aiguille, pincée entre deux doigts, et a dit : ça
monte ! Et Osgür, qui est le plus sensible aux règles de
bienséance, s’est peigné avec les doigts de sa main gauche pour
que, quand on allait sonner à la porte pour la première fois depuis
la dernière fois, l’impression soit la bonne. Olie l’Oursonne a mis
un grognement entre deux ronflements.
Olga
a dit : qui a passé la commande ?
Olaf
a cherché un coin où tourner son regard, un endroit où poser ses
yeux sans rencontrer d’autres yeux. C’était pas la première fois
qu’il tentait le coup et il était pas particulièrement surpris de
ne pas y arriver. Oncle Oscar a émis un pet sifflant, menaçant, et
Otto d’en Haut a grommelé : le trapèze ! Ne laissez pas
filer le trapèze ! Sauf que ça comptait pas, vu qu’il était
endormi et qu’il devait encore rêver à l’Amérique latine.
Olga
a attendu le retour du silence cuisine, qui est fait de cent petits
bruits d’ici et d’échos de tous les bruits derrière tous les murs,
puis elle a ajouté : j’espère que c’est pas quelque chose de
trop encombrant.
À
ce moment là ça a frappé à la porte. Douze coups. Le petit a fini
par tendre le bras et faire jouer le verrou. On pouvait tous voir
qu’il avait pris un coup de vieux.
Léo
2
10
de deniers : accroissement, richesse, biens ; opération
commerciale osée réussie.
Au
parlement des corbeaux, on ne s’agglutine pas par affinité
politique, l’emplacement des nids n’a aucune signification. Il n’y a
pas non plus de perchoir, ni de micro : chacun y croasse à
altitude égale et à à peu près le même volume sonore. Les
peupliers de printemps tardent à laisser repousser leurs feuilles et
la structure de la chambre est à nu. Ca ne dérange personne, tout
le reste de la zone est désert depuis plusieurs semaines.
La
première fois que je me suis arrêté en dessous, j’entendais sans
rien voir, sans comprendre d’où venait le barouf. D’où, entre le
campus du CNRS et la zone d’activité de Schiltigheim, on subissait
ce bruit de sous-bois, ces grincements de gésier, cette
entrelacement de croac croac. C’est qu’ils étaient planqués dans
les feuillages, alors, qu’ils faisaient encore leurs petites affaires
en catimini.
Le
dimanche, quand on se balladait par là-bas, on avait l’impression
d’être dans un film de SF, moitié soviétique, moitié cyberpunk,
moitié postapo. Le lac paysagé, l’hôtel quatre étoiles pour
cadres sup sup, l’hélico sur le toit de la banque, et puis juste
derrière, les champs de maïs à cochon et les collines avec les
bleds alsacofachos, les bosquets sauvages qui dénonçaient la
présence de bunkers semienfouis, totalement inextircables. Les gars
de la cité, aux beaux jours, amenaient des barbeucs et des scooters
sur les parkings de l’Espace Européen de l’Entreprise. Les corbeaux
laissaient faire. Ils étaient là depuis longtemps. Ils avaient le
temps.
La
dernière fois que je suis passé, le dernier jour où on avait
encore le droit de faire du vélo, les cris m’ont cueilli cent mètres
plus haut. Dans les branches nues, on pouvait compter les nids. Le
parlement, moitié perché, moitié envolé, avait gagné en
représentants et faisait un gribouilli en noir sur gris, quelque
chose d’illisible et d’un peu inquiétant.
Un
corbeau s’envole du sillon, une proie un peu lourde dans le bec, on
dirait qu’il galère avec la taille de ses ailes, avec le poids plume
de ses os pleins de rien, c’est du mouvement de précision, au
contraire, de l’expertiste finissime, la maîtrise shaolin du geste
parfait, en deux coups le piaf s’arrache du sol, il décolle, il
vole, nique toi bien, la gravité.
La
chaîne de mon vélo grince, j’ai les yeux qui piquent, le ciel est
percé de mille trous noirs minuscules, nous sommes pris dans nos
tours comme dans des pigeonniers, et les corbeaux, les corbeaux sont
encore là.
luvan 1
La terrasse.
Le khamsin y a soufflé un sable doré
le matin, brunâtre le soir, invisible et blanc au midi. Lorsque le
vent se calme, 50 jours syndicaux plus tard, je sors pieds nus, en
dépit des scorpions, pour la sensation de plage. Il fait chaud. Deux
semaines que les ventilateurs sont en rade. Des rats escaladent
l’intérieur de la gaine technique dans de petits tacs-tacs. Une
théière électrique bleu roi est posée là, au milieu, à côté
de l’arbre à kumquats, imberbe de poussière, lisse comme le
monolithe de 2001 L’Odyssée de l’espace. Une voix
radiohystérique low-tech provient de la terrase voisine, dont nous
sommes calfeutrés, depuis leur côté, par une barricade de joncs
secs. Au loin, le muezzin siffle un long gémissement crépitant.
Deux semaines que la sono de la mosquée sonne comme l’intérieur
d’un vieux tram bruxellois. Je soulève la théière. Elle est
vide, neuve, pas une éraflure. Si le vent l’avait portée
jusqu’ici, elle serait ensablée, avachie sur le flanc comme les
raffiots tristes du lac Baïkal. Autre chose l’a portée là.
La cuisine.
Il y a quinze jours, le frigo a rendu
l’âme dans un hoquet. On a tout mis dans une glacière, mangé ce
qu’on a pu, jeté le reste. Des mygales crochues crapahutent dans
la gaine technique. On entend des insectes la nuit. Ce matin, j’ai
délogé une scolopendre de ma basket. J’ai pété une dalle en
l’écrasant. J’ai brûlé le reste, qui s’est longtemps débattu
dans de grands déhanchis de colonne vertébrale, comme me l’a
appris à le faire la tante d’Ephehia. On vit d’huile d’olive,
de sel et de pains de ration. Ce matin, j’ai trouvé une machine à
espresso, rouge comme une mustang, sur le plan de travail. Les
autorités nous ont déposé des caisses en hélico. De l’huile
d’olive, du lait concentré, des médocs et des biscottes.
Le salon.
Une télévision neuve, câbles Hi-Fi
et tout le tintoin, comme dans les publicités des années 2030. Et
toujours pas d’électricité.
La chambre.
Deux mois sans électicité. On
n’entend plus la prière. Je la fais malgré tout par habitude,
dans l’espace qu’il me reste entre les monceaux de petit
électroménager. Le vent a repris, pâtine le tout comme un lavis de
jaune d’œuf. Je suis dans une nécropole, une ruine Maya. Les
autres sont partis ce matin et c’est moi qu’on a choisi comme
gardien. Le sol sent le sable et la pile oxydée. Dans la ville, les
autorités ont recensé 200.000 machines et 15.000 individus.
200.000. La population de Paris au XVIIème siècle. Heureusement
qu’il me reste mes bouquins d’histoire.
luvan 2
« Vous savez, cette histoire ? »
insiste Vera. « Cette histoire de coyote qui traverse une
rivière sur le dos d’une tortue et la bouffe une fois parvenu de
l’autre côté ».
Tout le monde s’esclaffe, surtout les
trois infirmères hopi.
« Un coyote ne peut jamais manger
de tortue » dit l’une d’entre elles.
« Trop de carapace, pas assez de
prise aux dents », renchérit Ernesto.
Le garde de sécurité nous a rejointes
dans la loge pour nous prévenir de l’évacuation, un chouïa trop
tard, et nous sommes toutes coïncées ensemble, à la lumière
strass-et-paillettes des bulbes jaunes.
Vera manœuvre avec agacement sa chaise
roulante pour la garer plus perpendiculairement à la table de
maquillage, un geste de colère que je l’ai vue faire plusieurs
fois.
Les loges de la maison de retraite
communautaire se trouvent en entresol. Depuis la petite fenêtre
grillagée donnant sur le trottoir pentu, nous voyons depuis ce matin
un drôle de spectacle. Une femelle coyote aux pis pleins s’est
installée pour mettre bas. La fenêetre est encastrée, en effet,
dans une sorte de niche en briques jaunes donnant sur la 63ème.
D’ordinaire, en proviennent les pets peu raffinées des vieilles
grosses bagnoles, les cris des gosses qui descendent la pente jusqu’à
la public school, puis la remontent le soir dans des rires fatigués
et machinaux. Depuis le Shelter, rien. Sauf ce matin où l’étrange
jappement mâtiné de miaulement de la coyotesse nous sert de
berceuse angoissante. Quand mettra-t-elle bas ? Ses pis sont
pleins.
Vera boude sur son siège métallique,
qui grince sous son poids. Et puis comme d’habitude depuis le début
de la quarantaine, quand c’est le silence depuis plus de trois
minutes, tout le monde me regarde, comme si c’était à moi
d’écrire la suite, de distribuer les rôles et les répliques.
Comme si j’étais toujours en charge du spectacle.
Je sens la sueur glisser entre mes
seins. Ça châtouille.
Heureusement, Tonio est pris d’une
formidable quinte de toux et la coyotesse se met à chanter en mi. Si
j’en sors vivante, promis j’abandonne la mise en scène et me
remets au sound design.
« Men ! With your…
sales ! » éructe Emilia, toujours bloquée sur son solo.
Et elle rit.
Je sens que je devrais dire quelque
chose, les encourager d’une manière ou d’une autre, mais Tonio
va crever et la coyotesse mettre bas. C’est inéluctable.
J’installe l’escabelle brimballante
sous la fenêtre et grimpe pour mater l’animale, son très long
museau, ses beaux yeux d’ancêtre omnisiciente. Lorsque je pose ma
main à plat sur la vitre, elle la lèche.
« Parfois, c’est l’inverse
qui se produit » raconte Renee, qui n’a pas voulu ôter son
maquillage ni son costume et ressemble toujours à une flapper de la
Prohibition. « Parfois, ce sont les migrants qui tuent leur
coyote ».
« Here we go again ! »
gémit Ernesto en anglais. « J’en ai vraiment marre de vos
histoires de traversée ».
À la fois, que reste-t-il d’autre ?
La
coyotesse met bas dans un hululement de grand-duc.
Stuart 1
C’était
un rêve. Une image, un flash back en noir et blanc, comme dans
certains films, vous savez ?
« L’idée du trapèze »,
me susurre l’ange à l’oreille.
J’entre dans le rêve comme on ouvre
les yeux au réveil, comme on entre en coulisse après le spectacle.
Sadako est là, qui me regarde, me scrute, jauge mes capacités à
passer d’un écran à l’autre, de la réalité intérieure à la
réalité extérieure. Par son regard elle me guide, coordonne chacun
de mes gestes ; je sens les fils qui me tiennent et font se
mouvoir mon corps sous le chapiteau monochrome.
« Nous sommes en direct de
Caracas », reprend l’ange.
Je lève le regard, absorbe le plafond
au creux de ma rétine, dévore la pellicule et le script d’un
clignement d’yeux.
Autour de moi, des explosions de
lumière, flashs de spectateurs fantômes.
Le film vacille et se brouille,
millions de pixels qui soudain floutent le décor, les distances, le
jeu auquel on m’invite.
Sadako arque le nylon des fils qui me
propulsent contre l’échelle apparue là, entre deux lézardes
cathodiques.
« Il est temps »
L’ange m’invite et me conduit vers
l’escalier de fonte ; chaque barreau est un trait fiché dans
le réel, une suture, une façon de faire tenir ensemble ce qui
tremble et chancelle.
Coupure – reprise – le film saute
et s’emballe.
Je me tiens au-dessus du vide.
L’ange affiche un sourire de
trampoline, un regard qui me berce et m’agite à la fois.
Le trapèze est un jeu auquel il est
possible de s’adonner toute une vie, pour peu que l’on sache
déchiffrer les saccades de l’écran et l’ombre des personnages
secondaires.
L’ange, et
Sadako.
Mes meilleurs amis.
« Il est temps. Nous sommes en
direct »
Mes mains enroulent le fer, mon corps
s’aligne avec l’idée du vide en dessous de moi. Il n’y a pus
de nylon pour me tenir, plus de fantômes à satisfaire, plus d’ange
pour compter mes points de vie ni me dire les règles du jeu.
Mes doigts serrés autour du plein,
par-dessus le vide.
Si je tombe, je pourrai retourner chez
moi.
Tour de manège, je m’élance.
Au loin, les sirènes de Caracas.
Stuart
2
Les animaux dans la ville
Le soleil
C’était comme un petit défilé de
lumière, une foudroyance douce et chaude froufroutant le long des
piliers de théâtres et du pavé des rues anciennes. Un tunnel une
colonne un rassemblement ordonné et foutraque de chants et de cris,
de grognements et de souffles fauves. Ça dévalait depuis le Jardin
des Plantes et puis dans tout Paris, dans les parcs abandonnés et
les places aussi vides qu’un bord de mer hivernal, sur le bitume
des routes foutues remplies de plantes sauvages. Et tout ce petit
monde dévoré prenait sa revanche, fantômes goguenards du vieux
Panam, spectres kawaii et pîtres d’un passé de bombes, de guerre
et de famine.
On était le matin.
On était au 232e jour du
confinement,
Un chiffre qui sonnait assez bien pour
que les animaux mangés du siège de 1870 s’éveillent en masse
pour s’en venir chahuter la ville évacuée. On ne savait plus très
bien s’il restait des humains à l’intérieur des murs, ça non.
On ne savait plus très bien s’ils avaient existé un jour. On se
souvenait de l’orage des canons et des couteaux de boucher, des
assassinats en direct et de la rafle du zoo.
Mais des humains d’aujourd’hui,
non. Peut-être que tout s’était arrêté une fois la ménagerie
vidée et le dernier ours débité en tranches fines de carpaccio
exotique, une fois le dernier chat flanqué de rat servi à la
clientèle huppée d’un restaurant grand luxe.
Miette, elle, se souvenait.
L’éveil des animaux, ceux de la
grande ménagerie, ceux du Jardin d’Acclimatation, l’avait tiré
de son sommeil sans rêve.
Une gosse, une gamine, mal mise et tuée
par trois mois de sièges. On avait poussé son corps au pied d’un
tas qui faisait trois fois sa taille, un tas de choses humaines qu’on
ne regardait plus et qui s’en allaient remplir les trous creusés
pour eux dans les rues alentour.
Miette, donc, se souvient.
En plein soleil, nimbée d’aurore et
de la joie du jour qui commence, elle marche dans la ville moderne et
lisse, blocs blancs sur blocs sables, routes grises et nettes malgré
l’insurrection végétale. Elle suit le flux doré des animaux
heureux, les canards bien vivants qui partent à l’aventure hors de
la jungle des cours, les coyotes venus du Mexique par de petites
embarcations de fortunes et arrivés dans la nuit.
La môme chante
et s’improvise meneuse de revue, danse une danse qui n’en finit
plus, libre et spectrale, fluide et animale, la petite gosse qui n’a
pas vu grand-chose du monde ni de la douceur humaine, la gamine morte
trop vite mais bien assez tôt au regard de ceux qui tiennent les
rennes et les banques, la celle qui a aimé et aime le chant au matin
des oiseaux et les barrissement, lointains, depuis son coin de rue
pourri, des éléphants du Jardin des Plantes, tout prêts, si près,
de l’éléphant géant de la Bastille qui la cache aux yeux des
passants, du plâtre rêche qui s’égrène entre ses doigts et des
vœux qu’elle prononce quand plus personne ne la chasse : « un
jour, j’aurais un éléphant. »